La substitution de la prescription de l’idéal (Dujarier, 2006) à la logique réglementaire de l’ancien rapport de travail a donné naissance à un univers d’exigences sans limites. Dans ce contexte où l’idéal s’est mué en norme (ibid.), l’individu, pressé par les obligations d’objectifs, doit s’affirmer en tant que sujet autonome, toujours actif et tout-puissant, enchanteur d’un nouveau monde (Barkat, Hamraoui, 2007 a). Monde où la mise en crise de soi est devenue institution (ibid., 2007 b) et où, comme nous le verrons, la pression des nouvelles organisations du travail s’exerce sur l’individu au moyen de techniques de pouvoir inédites – avec l’apparition corrélative de nouvelles formes de servitude (Dejours 2005 ; Hamraoui 2005 et 2007 b ; Molinier, 2005) – et de la subversion du sens des valeurs éthiques. Cette subversion tient, selon nous, à un phénomène totalement nouveau, caractéristique d’une époque où ce qui relève du seul mouvement – de fuite en avant – se donne à voir comme vie, où la passion du risque passe pour signe de courage.
I.
Avec la mise en place de l’individualisation des performances et le primat accordé à l’évaluation (Dejours, 2003) s’est peu à peu formée l’image d’un individu adaptable à la société « fluide » et « liquide » (Bauman, 2000), ou encore, « flexible » (Sennett, 2000 ; Aubert, 2004 a). Individu soumis aux tyrannies de l’idéal (De Gaulejac, 2006) et dont l’existence serait fondamentalement caractérisée par l’« intensité » (Aubert, 2004 b, pp. 73-87) – celle-ci contrastant avec le « vide » de l’existence de ceux qui ne peuvent ou ne veulent jouer le jeu. Tout entière concentrée dans l’instant, cette « vie intense » s’oppose à la « vie substantielle » où toute son importance est accordée à ce qui dure (Maffesoli, 2004), où l’expérience joue un rôle fondamental. À ces deux modes de vie correspondent deux images fondamentalement distinctes de l’homme. Comment en définir la singularité ? En s’appuyant, selon nous, sur l’analyse des valeurs et des systèmes d’évaluation de l’engagement de l’individu que véhicule et promeut le nouveau rapport de travail. Concernant la question des valeurs, nous avons choisi de montrer en quoi l’actuelle mise en exergue du courage, au sein de la société en général, et de l’Entreprise en particulier (Enriquez, 1997, p. 124), constitue un indice déterminant de la transformation de l’image de l’homme actuellement en cours. Cette valorisation du courage, qui s’opère au prix d’une redéfinition de son concept, s’inscrit elle-même dans le cadre d’un système d’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés. Dans ce système où l’acte de production ne peut plus se prolonger en métier, lequel suppose l’engagement du corps selon des modalités irréductibles aux gestes attendus d’un sujet exclusivement rationnel (Barkat, Hamraoui, 2007 a), le courage ne trouve plus à s’exprimer comme vertu (force) d’une expérience sensible.
II.
Traditionnellement associé à la force et à la grandeur de l’âme, ou encore à la générosité et à la sensibilité (Hamraoui, 2001), le courage est aujourd’hui devenu synonyme d’endurcissement et d’impavidité, dans un contexte où le risque est considéré non seulement comme critère de reconnaissance de la valeur intrinsèque des individus, mais encore comme principe de hiérarchie entre eux (Ewald, Kessler, 2000). Associé à une virilité comprise comme capacité – érigée en compétence – à demeurer impassible devant sa propre souffrance ou celle infligée à autrui (Dejours, 1998), le courage se trouve aujourd’hui opposé à la peur du changement ou à celle suscitée par les nombreuses situations à risque qui se rencontrent dans le monde du travail. Ce dernier point de vue, forgé sur la base d’enquêtes cliniques réalisées dans des secteurs d’activité aussi divers que le BTP, la chimie, le nucléaire, la police, l’armée, etc., se trouve aujourd’hui ignoré, voire occulté par ceux qui, comme le philosophe Michel Lacroix (2003), soutiennent que « nous assistons actuellement à l’émergence d’un véritable idéal de vie courageuse, qui plonge ses racines au plus profond de l’imaginaire contemporain ». En effet, poursuit Michel Lacroix, « aux valeurs hédonistes de Mai 68 se substituent les rêves héroïques. Le défi courageux remplace le plaisir comme moyen d’épanouissement. L’audace prend le pas sur la liberté sexuelle, Polemos sur Éros » ! La « vie courageuse » constituerait ainsi « la forme la plus actuelle de l’accomplissement personnel » (Lacroix, 2003, p. 39). En effet, ajoute Michel Lacroix, le courage rassemble « l’exigence de moralité et l’incarnation dans la corporéité en une synthèse qui correspond pleinement aux aspirations d’aujourd’hui [où le corps est devenu] centre de force » (ibid., p. 43). La seule ombre au tableau ici envisagée est le risque de « perversion » du courage dont l’invocation ne va jamais sans rappeler la violence et l’esprit belliqueux. Mais cette manière de poser le problème est-elle philosophiquement adéquate à la réalité de notre temps ?
À la thèse du « courage réinventé », soutenue par Michel Lacroix, nous opposons celle d’une éviction du courage de son lieu de définition traditionnel. Cette éviction est, selon nous, le corollaire de la mutation de l’image de l’homme dont le nouveau rapport de travail – non questionné par Michel Lacroix – constitue l’un des principaux vecteurs. Le courage n’est plus aujourd’hui associé à la sagesse et à « la science des choses à craindre ou, au contraire, à désirer » (Platon). Il n’est plus « ardeur mesurée » (thumos) (Frère, 2004) disposée à l’écoute de l’intimité de la vie des choses et des êtres (Barkat, 2007 a). Idéalisé ou confondu avec la passion du risque (Le Breton, 2000), le courage constitue l’une des vertus cardinales de la « société du risque » (Ewald, Kessler, 2000) – que nous hésitons à qualifier de post-hédoniste (la passion du risque est jouissance). Mais en quel sens ? Ayant cessé d’habiter son lieu de définition sensible et rationnel, le courage n’en est plus que l’occupant insensible, « viril » (Dejours, 1998) et « risquophile » (Castel, 2000), se donnant à voir sous le masque de la vertu.
III.
Loin d’être le fruit de l’action d’un malin génie abusant notre entendement, ce subterfuge est rendu possible par une opération de vidage de la substance éthique du courage effectuée par les « sujets imaginaires » promus par les schémas d’organisation actuels de la production et la soumission aux procédures d’évaluation. Celle-ci, comme le montre Sidi Mohammed Barkat (2008), « propose des valeurs au monde du travail et l’interprète. Elle s’engage dans la réalisation de ce qui est sans doute l’un de ses objectifs essentiels de portée métaphysique : construire la fiction d’un sujet comme identité permanente » et image de la toute-puissance. Ce sujet imaginaire a perdu la notion de son ancrage dans le corps, lequel « seul sait entretenir avec les choses et les autres la relation d’intimité qu’ils appellent » (ibid.) : « C’est, ajoute Sidi Mohammed Barkat, le corps qui pense cette relation […], c’est lui qui demeure attentif à la sagesse, à la prudence [et à] la modestie qui irradient l’activité de travail […] et permettent à la multiplicité qu’est l’individu de s’affirmer, à la pluralité de se réaliser, à la variation de s’accomplir. [C’est pourquoi,] en maintenant le sujet dans l’incapacité d’éprouver pleinement la complexité du travail, l’évaluation tient la conscience à l’écart du mouvement de la vie, interprété désormais comme la manifestation d’un agir incompatible avec les exigences de la raison » (ibid.). Ces exigences découlent du primat des rationalités logique et instrumentale auxquelles l’homme « courageux » agissant dans les sphères de l’entreprise ou de la politique se soumet comme à une absolue nécessité. Ces exigences sont aussi celles de la société du risque qui requiert la capacité à s’arracher perpétuellement à soi, à ses systèmes de représentation et de valeur (Sennett, 2000). Dans cette société, le risque est conçu tout à la fois en tant que « morale », qu’« épistémologie », qu’« idéologie », que « manière de définir la valeur des valeurs » (Ewald, Kessler, 2000). Il s’agit là, de notre point de vue, moins d’un retournement du sens moral (Dejours, 1998, p. 99), d’une « alchimie sociale grâce à laquelle le vice est transmuté en vertu » (ibid., p. 100), ou encore d’un triomphe de l’idéologie, que d’un phénomène totalement inédit, caractéristique d’une séquence historique ouverte avec l’élaboration des structures du capitalisme parlementaire, à partir des années 1860. Ce système institutionnel est aujourd’hui parvenu, comme le montre Sidi Mohammed Barkat (2007 a), à « [faire] passer l’agrégat des sujets imaginaires pour la communauté ouverte des travailleurs, la lourdeur de la production pour la légèreté du travail, la polyvalence professionnelle pour la pluralité de l’individu, la maladie pour la santé, la fuite en avant du sujet pour l’extravagance du corps. Bref – et cela est sans doute ce qui […] singularise [le système] en profondeur –, il donne à la mort le visage de la vie ».
IV.
Revenons, pour conclure, sur cette dernière idée. La mort dont il est ici question n’est pas la « mort totale » aussi radicalement et chronologiquement (« dans l’instant ») désunie de la vie que la nuit l’est du jour (Tertulien, De anima). Son temps s’est dilaté. Elle revêt la figure de la pure indétermination. Elle est mort indéterminée, état où la seule animation se donne à voir comme vie au moyen d’artifices de pouvoir permettant de soutenir l’activité de corps dont la vie a été évincée, réduits à l’état de somme d’énergie. Un coeur continue pourtant de battre dans ces corps-opérateurs, d’être présent dans leur topographie. Mais ce coeur n’est plus le lieu d’affirmation de la dimension sensible de l’homme qui le relie aux autres et aux choses (Hamraoui, 2007). La conscience et le cerveau, qui en est le support neurologique, sont devenus les seuls critères de définition de l’homme et de sa vie. L’extinction de leur activité signe seule le passage de la vie à la mort. Le sujet de la société du risque est fondamentalement définissable en tant que « sujet cérébral » (Vidal, 2006), dont la vie et les actes ont cessé d’être inspirés par le coeur, et qui fait fi des limites de son corps. L’épuisement qui en résulte est un temps rendu supportable par la promotion de l’image de soi (Barkat, 2008). Toutefois, «lorsqu’il devient trop pressant, un tel dispositif ne laisse aucune issue à l’individu en dehors d’un saut effectué hors du système par l’usage rendu inéluctable d’une violence retournée contre soi (la maladie et la mort) » (ibid.).
1 Communication présentée à Strasbourg, le 5 octobre 2007, à l’occasion du 60e anniversaire de l’Association « Alsace-Santé-Travail » (AST).
2 Maître de conférences en philosophie à la Chaire de Psychanalyse-Santé-Travail du CNAM (Paris).
Bibliographie :
Aubert N. & coll. (2004 a), L’individu hypermoderne, Paris : Érès.
Aubert N. (2004 b), L’intensité de soi, L’individu hypermoderne, Paris : Érès, pp. 73-87.
Barkat S.M. (2008), L’évaluation, le travail et la vie, La situation de crise dans l’intervention, Toulouse : Éditions Octarès, à paraître.
Barkat S.M., Hamraoui E. (2007 a), « Le sujet et son double : nouveau mode de désubjectivation dans le travail », à paraître dans les actes de la Journée d’études « Philosophies de l’individualité XIXe-XXe siècles » co-organisée par C. Lefève et E. Halais, Centre d’Études du Vivant – Centre Georges Canguilhem – Université Paris VII, 6 avril 2007.
Barkat S.M., Hamraoui E. (2007 b), De la crise comme exception à la crise-institution, Toulouse : Éditions Octarès, pp. 13-23.
Bauman Z. (2000), Liquid Modernity, Cambridge : Polity Press.
Castel R. (2000), « Risquophiles, risquophobes : l’individu selon le Medef », Le Monde, 6 avril.
Dejours C. (1998), Souffrance en France, Paris : Seuil.
Dejours C. (2003), L’évaluation du travail à l’épreuve du réel. Critique et fondement de l’évaluation, Paris : Éditions INRA.
3 Celui-ci consiste en un glissement et une inscription de la structure de pouvoir inhérente au système de production dans le travailleur « de telle sorte qu’il se partage, pour ainsi dire de l’intérieur, en maître et exécutant de la production » (Barkat, Hamraoui, 2007 a) : « Le rapport de production ne sépare pas deux catégories de personnes, mais s’inscrit à l’intérieur du travailleur et le divise en deux. L’image qui se forme ainsi est celle d’un individu absolument libre, acquérant la force d’une instance autonome de production, et assumant les risques lui afférant. Dans ce dispositif, la possibilité de se voir éliminé du champ de l’emploi prend la figure du risque principal, et sa réduction semble devoir passer essentiellement par la capacité de chaque travailleur à faire pression sur lui-même afin de se rendre entièrement disponible dans la perspective d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs de plus en plus en plus élevés qui lui sont assignés de l’extérieur » (ibid.). 6
Dejours C. (2005), Nouvelles formes de servitude et suicides, Travailler, 13 : 53-73.
Enriquez E. (1997), Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, Paris : Desclée de Brouwer.
Ewald F. & Kessler D. (2000), Les noces du risque et de la politique, Le débat, 109 : 54-72.
Dujarier M.-A. (2006), L’idéal au travail, Paris : PUF.
Gaulejac V. de. (2006), préface à L’idéal au travail de Marie-Anne Dujarier.
Hamraoui E. (2001), Les courages : variantes d’un processus d’androsexuation de la vertu, Travailler, 7 : 167-188.
Hamraoui E. (2005), Servitude volontaire : l’analyse philosophique peut-elle éclairer la recherche du clinicien ?, Travailler, 13 : 35-51.
Hamraoui E. (2007 a), article « Coeur », Dictionnaire du corps, Paris : PUF, pp. 208-213.
Hamraoui E. (2007 b), article « Servitude », Dictionnaire du corps, Paris : PUF, pp. 860-864.
Lacroix M. (2003), Le courage réinventé, Paris : Flammarion.
Le Breton D. (2000), Les Passions du risque, Paris : Éditions Métailié.
Maffesoli (2004), De l’identité aux identifications, in L’individu hypermoderne, sous la dir. de N. Aubert, Paris : Érès, pp. 147-156.
Molinier P. (2005), De la condition de bonne à tout faire au début du XXe siècle à la relation de service dans le monde contemporain : analyse clinique et psychopathologique, Travailler, 13 : 9-33.
Sennett R. (2000), Le travail sans qualités. Les conséquences humaines de la flexibilité (1998), trad. P.-E. Dauzat, Paris : Albin Michel (10/18).
Vidal F. (2006), Les Sciences de l’âme, XVIe-XVIIIe siècle, Paris : Honoré Champion éditeur.
7
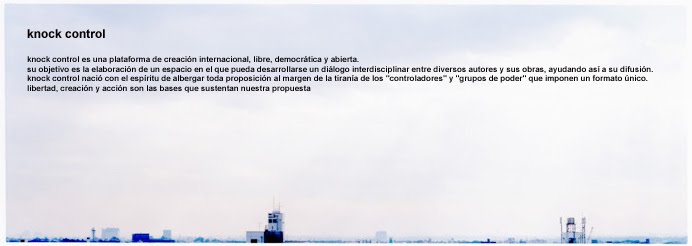
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire